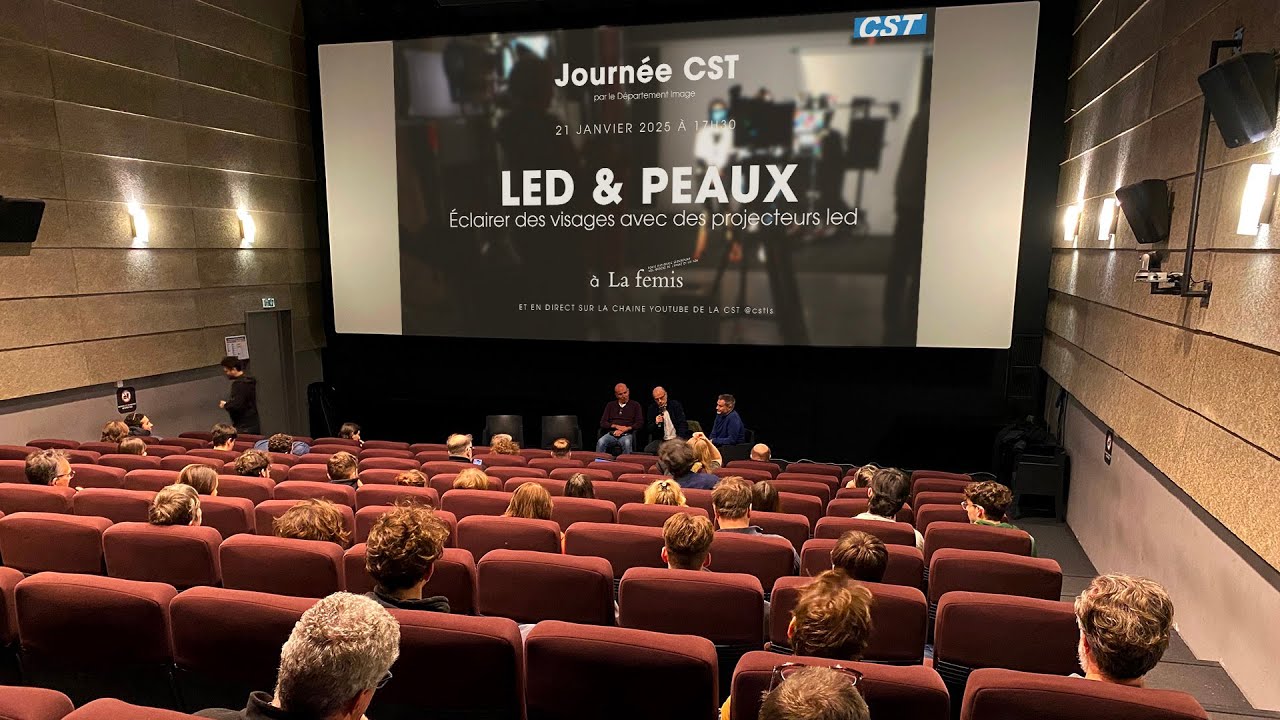Dans « Le murmure des photons », j'évoquais ce voyage prodigieux qu'accomplit chaque particule de lumière avant de venir mourir au fond de ma rétine ou sur le capteur de ma caméra. Un photon né dans l'intimité brûlante du Soleil, prisonnier des dizaines de milliers d'années d'un labyrinthe incandescent, puis libéré pour traverser le vide en huit minutes, rebondir sur un visage, et finalement s'éteindre sur une surface sensible. Ce trajet ininterrompu me semblait constituer le garant ultime de toute image : une chaîne causale reliant le cœur d'une étoile à l'émotion d'un spectateur.
Mais voilà qu'apparaissent des images qui n'ont jamais connu ce voyage. Des visages que nul photon n'a jamais effleurés. Des lumières qui n'ont existé nulle part ailleurs que dans les probabilités d'un réseau de neurones.
Qu'avons-nous perdu, ou gagné, en coupant cette chaîne ?
Le certificat de présence
Une photographie, même ratée, atteste d'une rencontre. Quelque chose a touché quelque chose d'autre. Le photon qui a rebondi sur ce visage-là, ce jour-là, est venu ensuite frapper l'émulsion ou le silicium. Une continuité physique absolue.
Sur un plateau, quand j'oriente un projecteur vers une comédienne, je dirige des milliards de ces voyageurs microscopiques vers son visage. Ils traversent l'air, caressent sa peau, rebondissent selon la géométrie de ses pommettes et la texture de son maquillage. Une infime fraction parvient jusqu'à l'objectif et vient mourir sur le capteur.
Cette mort est précieuse. Elle est la preuve que le voyage a eu lieu.
La seconde transmutation
Le voyage ne s'arrête pas au capteur. Ni à la rétine.
Quand un photon meurt au fond de mon œil, il déclenche une cascade biochimique dans les cellules photoréceptrices. Cette cascade se propage le long du nerf optique, atteint le cortex visuel. Là, quelque chose d'extraordinaire se produit : l'énergie lumineuse devient autre chose. Information. Profondeur. Émotion.
Je vois un visage triste. Je perçois une menace dans l'ombre d'un couloir. Rien de tout cela n'existe dans le photon lui-même. C'est mon cerveau qui transmute ces impacts lumineux en expérience vécue.
Le peintre, lui aussi, a connu ce voyage. Les photons ont traversé l'espace, rebondi sur le monde, atteint ses rétines, déclenché la cascade neuronale. Son cerveau a transmué ces impacts en perceptions, en souvenirs. Sa main a guidé le pinceau. La toile a reçu l'empreinte d'une vision qui, elle-même, était née d'un trajet réel.
Entre le Soleil et la toile, la chaîne physique n'est pas rompue. Elle passe simplement par un relais supplémentaire : la conscience du peintre.
L'image orpheline
L'image générée par intelligence artificielle rompt cette chaîne.
Aucun photon n'a jamais voyagé pour elle. Aucun n'a rebondi sur le visage qu'elle représente. Elle émerge d'un calcul statistique, d'une moyenne pondérée de millions d'images antérieures — qui, elles, étaient bien nées de voyages réels.
L'IA hérite indirectement du trajet des photons, via les données d'entraînement. Mais cet héritage est infiniment dilué. Des millions de trajets anonymisés, moyennés, fondus en un brouillard probabiliste.
Ce qui manque à l'image IA, ce n'est pas toute lumière. C'est une lumière singulière, datée. Une lumière qui aurait touché ce visage-là, ce jour-là.
Le simulacre parfait
Le plus troublant, c'est la perfection du mimétisme.
L'IA simule admirablement le résultat du voyage sans jamais l'avoir effectué. Grain de peau, reflets spéculaires, profondeur de champ : tout y est. Elle reproduit jusqu'aux stigmates du trajet : le flou de bougé, le bruit en basse lumière. Autant de traces d'un périple qui n'a jamais eu lieu.
Elle mime l'empreinte sans avoir connu le doigt.
Et parfois, ses images paraissent plus réalistes que le réel. Plus conformes à ce qu'une image devrait être. L'accident a disparu. Le hasard s'est évaporé. Ne reste que la vraisemblance pure.
La nostalgie du trajet
Notre fascination pour le photoréalisme des images générées révèle peut-être une nostalgie paradoxale.
Pourquoi vouloir que ces images ressemblent à des photos ? Pourquoi réinjecter artificiellement le grain argentique, les aberrations optiques, tous ces stigmates du voyage réel ?
Peut-être cherchons-nous à maintenir l'illusion du lien, même rompu. À faire comme si le photon était passé par là.
Les premiers générateurs d'images produisaient des résultats étranges, manifestement artificiels. Les plus récents s'efforcent de disparaître, de passer pour ce qu'ils ne sont pas. Cette dissimulation a quelque chose de vertigineux. Non pas parce qu'elle trompe (toute image trompe) mais parce qu'elle trompe sur la nature même de la tromperie.
Du chasseur à l'architecte
Sur un plateau, je suis un chasseur de photons.
Je tends des pièges à la lumière. Je guette le moment où elle « sonnera juste », cet instant suspendu où chaque particule semble trouver spontanément sa place. Mais je ne la crée pas. Elle vient d'ailleurs — du Soleil, des lampes, des reflets du monde. Mon rôle est de la capturer au terme de son voyage.
L'opérateur d'un générateur d'images n'est plus un chasseur. Il ordonne des configurations statistiques pour faire émerger une image qui n'existait nulle part avant son geste. Il est devenu architecte des possibles.
Le chasseur dépend du gibier. L'architecte ne dépend que de son plan. Le chasseur compose avec le hasard, l'imprévu. L'architecte élimine ces contingences. Et pourtant, tous deux connaissent l'échec — les prises ratées sur le plateau, les prompts qui n'aboutissent pas. Ce tâtonnement partagé crée peut-être une parenté inattendue.
Le lien rompu
Dans « Le murmure des photons », j'écrivais que chaque visage éclairé devenait le reflet d'un dialogue entre l'univers et notre présence au monde. Le photon, messager du cosmos, venait mourir sur le capteur après avoir touché un fragment de réel. Cette mort était le gage d'une rencontre.
L'image générée est peut-être la première image qui ne connaît pas cette mort, parce qu'elle n'a jamais connu cette vie.
Nous entrons dans l'ère de l'image immortelle, qui ne doit plus rien à la matière mais tout à la structure.
Et pourtant, quelque chose résiste. Un vertige sourd. Comme trouver sur le sable très fin d'une planète qu'aucun humain n'a jamais visitée l'empreinte d'un pied nu — si précise qu'on y distingue les sillons de la peau et le léger dérapage du talon de quelqu'un qui s'élançait vers le ciel.






.jpg)